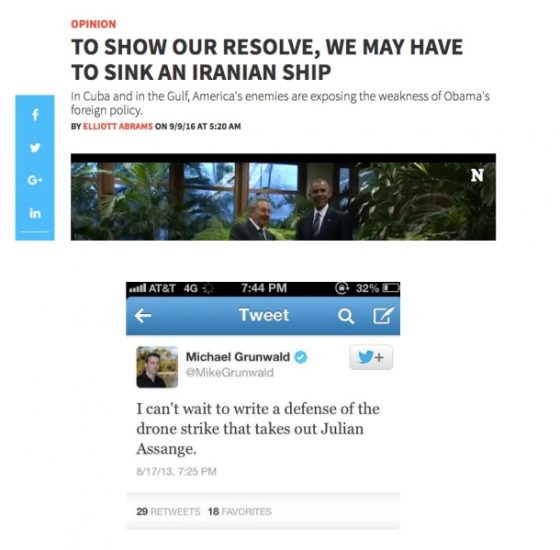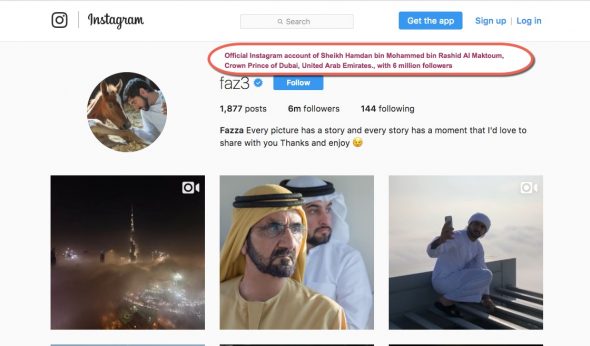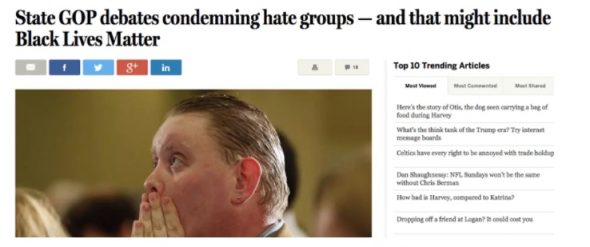Les témoignages de victimes attestent d’une pratique répandue et organisée par le régime. Agressées, ces femmes se heurtent aussi au rejet d’une société qui les considère salies.
En ce jour ensoleillé et doux de décembre 2013, Maya (1) n’imagine pas ce qui l’attend. Cette mère au foyer de 31 ans se rend dans l’un des principaux centres de détention des services de renseignement militaire de Damas pour essayer de savoir ce qu’est devenu Ahmed, son mari. Sans nouvelles depuis son arrestation lors d’une opération militaire contre un bastion de l’opposition il y a plusieurs mois, Maya est rongée par l’inquiétude. Accusée d’être «l’épouse d’un terroriste», elle est immédiatement incarcérée. Au bout de quelques jours, elle est convoquée pour un interrogatoire. Dans un bureau rempli de gardes, elle se retrouve face à son mari, couvert de marques de coups. «Son regard me disait : pourquoi es-tu venue ici ?» se souvient Maya. L’officier, qui se fait appeler Sidi («mon maître» en arabe), menace Maya de viol collectif et de violer ses enfants si Ahmed ne parle pas. «Je me suis jetée à ses pieds en le suppliant de ne pas me faire de mal. Il a alors proposé de me libérer si mon mari et moi avions une relation sexuelle devant eux, raconte Maya la voix brisée. Ils ont traîné mon mari sur moi, mais il était comme paralysé. Alors l’officier a appelé un des gardes et lui a ordonné de me violer. J’étais dans un état second.»
à lire aussi En Syrie, «baiser toutes les femmes pour les punir»
Les semaines qui suivent, Maya est interrogée plusieurs fois, seule. Parce qu’elle ne parle pas, elle est violée en réunion par les gardes à deux reprises. Sidi leur promet un mois de permission s’ils miment un film pornographique qu’il regarde en même temps à la télévision. «Je me disais qu’ils me libéreraient peut-être après ça», confie la jeune femme à voix basse. La nuit, impossible de trouver un bref répit dans le sommeil. Les cris des autres détenues l’empêchent de dormir. «J’entendais des femmes supplier les gardes de les frapper mais de ne pas les violer. On ne peut pas oublier ces cris. C’est comme si quelqu’un criait à l’intérieur de votre tête», se souvient Maya. Libérée après encore plusieurs longs mois de détention, la jeune femme vit toujours en Syrie.
«Tu veux la liberté ?» De nombreuses ex-détenues dévoilent des récits similaires de violence sexuelle dans les centres de détention des services de renseignement à travers le pays. Malina, une activiste de 31 ans (lire aussi page 5), a été détenue dans la même prison que Maya quelques mois avant elle. Dès son arrivée, les gardiens la déshabillent, comme tous les activistes capturés ce jour-là – hommes et femmes – et les font se tenir entièrement nus, en cercle, pendant qu’ils les inspectent. «Tu veux la liberté ? La voilà ta liberté ! dit un garde en insérant ses doigts dans le vagin de Malina. On va te donner la liberté sexuelle !» «Il faisait cela pour m’affaiblir. Je me disais que j’étais très forte et qu’ils ne me faisaient pas peur. Même s’ils abusaient de moi», se souvient Malina. Elle sait d’autant plus ce qu’elle risque qu’elle a déjà été violée lors d’une précédente détention quelques mois auparavant, en guise de représailles pour avoir refusé d’espionner son groupe d’activistes pour le compte du gouvernement.
Asma a été arrêtée en 2014 parce que son mari était recherché pour avoir manifesté. Les agents d’un centre de détention de Damas la torturent avec des câbles qui lui envoient des décharges électriques sur les seins puis la violent à plusieurs reprises. Loubna aussi a été torturée à l’électricité et violée. A cause de ces violences, elle a fait une fausse couche.
Yasmine, elle, a été dénoncée parce qu’elle distribuait de l’aide humanitaire dans la banlieue de Damas. Arrêtée, elle est abusée sexuellement lors des interrogatoires, torturée, puis violée quatre fois. Zeina, une infirmière qui soignait les rebelles dans un hôpital clandestin de Homs, le bastion de la révolution, a été détenue un an par les services de renseignement militaire. Au cours d’un interrogatoire, un agent la frappe avec un tuyau, puis lui dit : «Comme tu es sunnite, on va te faire ça !» avant de la violer. Les onze compagnes de cellule de Zeina, dont une sexagénaire, lui confient ensuite avoir aussi été violées. «Sois forte, ce qui t’arrive nous est aussi arrivé» lui souffle l’une d’elles.
Au fil des témoignages s’esquisse une pratique récurrente à travers le pays et dans le temps. Si les activistes comme Malina ou Yasmine sont les cibles privilégiées, de nombreuses victimes n’étaient pas engagées dans la révolte. Epouses, sœurs d’opposants ou même simples habitantes de quartiers étiquetés «pro-révolution» subissent des violences sexuelles. «Au début, les viols avaient principalement pour but de dissuader les gens de rejoindre la révolution. Bachar al-Assad envoyait ainsi le message qu’il ferait n’importe quoi pour écraser la révolte», explique Sema Nassar, militante syrienne des droits de l’homme et auteure de plusieurs rapports sur les violences commises en détention. Certaines femmes racontent que leur famille leur interdisait de se joindre aux manifestations par crainte d’agression sexuelle.
«Ennemie». Les fréquents récits de viols en 2012-2013 semblent indiquer un pic à cette période, sans doute lorsque le régime s’est senti le plus menacé. «Plus tard, violer les femmes était une façon de les punir pour leur engagement. C’est une des armes favorites du régime car elle ne coûte rien et les femmes restent stigmatisées et affectées, même une fois sorties de prison», ajoute Sema Nassar. Terroriser, punir, soumettre. Une stratégie employée tout au long du conflit par le régime.
Les viols n’ont pas lieu uniquement dans les prisons. Les femmes courent le risque d’être agressées sexuellement lorsqu’elles passent les check-points pour sortir ou rentrer dans leur quartier. Transporter des médicaments, une caméra ou avoir des photos de la révolution sur un téléphone suffit à les mettre en danger. Dans les guérites supervisées par les chabiha, les milices pro-régime, c’est la roulette russe lors de la fouille et du contrôle d’identité. A tel point qu’à la nuit tombée, beaucoup de femmes n’osent plus passer sans un homme de leur famille pour les escorter.
Au début de la guerre, lors d’offensives militaires pour reprendre certains quartiers ou villages à l’opposition, les soldats de l’armée syrienne ont aussi violé les résidentes, comme une arme indissociable de leur attaque. A l’automne 2012, l’armée syrienne lance une opération pour reconquérir Qaddam, un quartier traditionnel de classe moyenne dans le sud de Damas, dominé par l’opposition. Alors que toute la population a fui, Maryam, une grande femme de 27 ans au visage encore enfantin encadré par un voile serré, retourne chercher quelques affaires chez elle. Elle est alors arrêtée par un groupe de soldats. Ils la pressent pour savoir si elle est affiliée aux «terroristes». «Pour eux, j’étais une ennemie, une terroriste car je venais de ce quartier. Ils voulaient me punir», dit la jeune femme. La nuit tombe. Les soldats attachent Maryam sur une banquette à l’arrière d’un minibus. «Un officier est arrivé et s’est assis à côté de moi, tandis que deux soldats se tenaient derrière. L’officier a mis sa main sur ma cuisse, raconte-t-elle les yeux baissés en se tordant les mains nerveusement. J’ai crié. L’officier m’a menacé : « Si tu cries, je vais te tuer ! » et un des soldats a mis sa main sur ma bouche. Les trois hommes ont commencé à me toucher partout, y compris sur mes parties intimes. Je ne voyais rien car il faisait trop sombre, mais j’entendais qu’ils se masturbaient.» L’officier force Maryam à lui faire une fellation tandis que les deux autres hommes continuent à la toucher. «Ensuite, l’officier m’a enlevé mon pantalon. Je l’ai supplié de ne pas faire ça. Il est monté sur moi et je me suis évanouie, continue la jeune femme avec difficulté. Quand je suis revenue à moi, il était en train de remettre son pantalon et il est sorti du minibus. J’ai ressenti une forte douleur dans le vagin. J’ai beaucoup saigné les jours qui ont suivi et j’ai eu une infection.»
Tabou. Maryam est transférée dans une prison d’où elle est libérée au bout de trois jours, à condition de signer une promesse écrite de ne jamais révéler ce qu’elle a enduré. «Personne ne le sait dans ma famille. Ils me feraient des reproches et me diraient que je n’aurais pas dû retourner là-bas», précise-t-elle, aujourd’hui réfugiée en Turquie, mariée et mère d’une petite fille.
La plupart des victimes se taisent car pour la majorité des Syriens, le viol constitue le tabou ultime. «C’est pire que la mort, dit un avocat originaire de Homs. J’aurais plus peur du viol pour ma femme et ma fille que de la mort.» Dans une société largement patriarcale et conservatrice, l’honneur des femmes est central dans l’ordre social. Une femme violée est perçue comme déshonorée et ce déshonneur rejaillit sur sa famille. Double peine cruelle, nombre de victimes de viol ont été rejetées par leur famille, répudiées par leur mari qui a immédiatement demandé le divorce et conservé la garde de leurs enfants.
Dans les cas les plus extrêmes, certaines ont été poussées au suicide. «Une mère m’a raconté que sa fille de 23 ans s’était suicidée car elle n’avait pas pu supporter la réaction de sa famille, raconte Sema Nassar. A sa sortie de prison, elle était enceinte, son fiancé l’a quittée, son père et son frère l’insultaient. Son père la cachait en disant à tout le monde qu’elle était en voyage. Désespérée et à bout, elle s’est jetée du cinquième étage de sa maison. Quand elles ne les ont pas rejetées, beaucoup de familles ont quitté le pays avec leur fille pour échapper à la honte.» Le viol a ainsi contribué à vider la Syrie de ses opposants.
Selon des témoignages indirects, les viols continuent actuellement dans les geôles du régime. «Il est effrayant de voir que même en position de force, le régime continue à agresser sexuellement les détenues, relève Sema Nasser.Il veut prendre sa revanche sur les activistes qui se sont opposés à lui.»
(1) Les prénoms ont été changés.