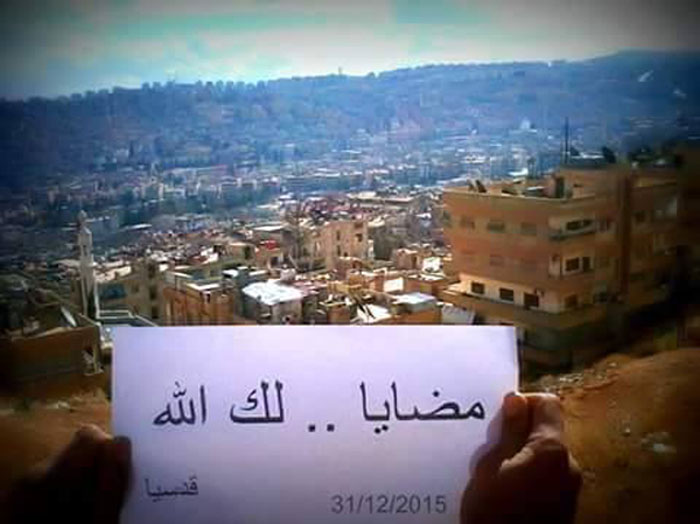Manifeste pour une histoire de la révolution en Syrie.
(Grotius international – Géopolitique de l’Humanitaire, novembre 2013)
par Pierre PICCININ da PRATA
Historien – politologue (otage en Syrie – avril à septembre 2013)

« Il n’y a de Dieu que Dieu » (Alep) – photo © Edouardo Ramos Chalen
 [Photo : PPdP avec une katiba islamiste à Alep, dans le quartier de Karm al-Jabal – © Benoit De Freine]
[Photo : PPdP avec une katiba islamiste à Alep, dans le quartier de Karm al-Jabal – © Benoit De Freine]
« Il est une expression en deux mots », écrivait l’académicien français Bernard Le Bouyer de Fontenelle, « qui nous rappelle que le temps n’est pas à notre disposition : ‘trop tard !’ »
Encore trop souvent simplifiée à outrance par des commentateurs très éloignés des événements et présentée comme la révolte d’un peuple uni contre un féroce dictateur, la révolution syrienne, au regard de ceux qui l’ont accompagnée de mois en mois et observée sur le terrain, n’est pas le phénomène statique qu’évoquent généralement les médias.
Tout au contraire, le conflit syrien a connu plusieurs phases très distinctes et une évolution rapide qui a surpris et déconcerté, par sa vélocité et la diversité des protagonistes qui se sont invités sur le théâtre, même les experts les plus avertis.
Enlevé dans la ville d’al-Qousseyr (Homs), le 8 avril 2013, alors que j’effectuais un huitième voyage d’observation en Syrie depuis le début de la révolution, je suis resté deux mois prisonnier de bandits qui agissaient sous l’étiquette de l’islamisme et, trois autres mois durant, des islamistes « modérés » des Brigades al-Farouk. En sus, pendant une semaine, j’ai été confié à la garde d’une brigade de Jabhet al-Nosra, la présumée branche syrienne d’al-Qaeda.
Régulièrement déplacé à travers le pays sans être empêché ni de voir, ni d’entendre, j’ai pu me rendre compte de l’évolution spectaculaire du conflit syrien qui, aujourd’hui, est entré dans sa quatrième phase, très largement dominé par les différentes factions djihadistes, présentes sur la majorité du territoire, d’une part, et, d’autre part, par des bandes de malfrats, parfois issus de l’Armée syrienne libre (ASL), qui ont profité du chaos ambiant pour étendre leur mainmise sur des villages ou quartiers dont ils ont mis les populations en coupe réglée.
L’Armée syrienne libre, quant à elle, de plus en plus reléguée à la portion congrue, a perdu le leadership de l’opposition au gouvernement et, de plus en plus souvent, doit combattre les djihadistes qui tentent désormais de la déloger de ses positions pour en prendre le contrôle, au point de proclamer en Syrie la création d’un califat indépendant.
Il ne s’agit pas, dans cet article, de produire le récit de ces cinq mois de détention, mais de brosser le tableau d’un conflit en perpétuelle évolution et d’en dégager les principales conséquences pour la région moyen-orientale et l’Europe.
Précaution nécessaire avant de m’essayer à cet exercice, il convient probablement de préciser que, humaniste engagé aux côtés de l’Armée syrienne libre depuis mai 2012, je confirme tout mon soutien à sa cause juste et légitime, face à la férocité d’une dictature criminelle et mafieuse et, dorénavant, face, également, à l’intolérance et à la violence de l’islamisme militaire.
Bilan raisonné d’un conflit d’un nouveau genre…
*
* *
1. Le « Printemps syrien » (15 mars 2011 – mai 2012)
La Syrie est l’un des six pays du Monde arabe qui connaissent depuis le début de l’année 2011 des troubles conséquents ayant pour contexte l’ainsi dénommé « Printemps arabe » (avec la Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Yémen et le Bahreïn).
Toutefois, la crise syrienne, qui s’est muée en conflit armé particulièrement meurtrier, conflit qui s’est progressivement étendu à toutes les régions du pays et perdure depuis près de trois ans, semble ne pouvoir se résoudre d’aucune manière.
Contrairement aux cas de la Tunisie et de l’Égypte, où le pouvoir était plus fragile qu’on avait pu le croire et fédérait contre lui la plupart des éléments constitutifs d’une société ethniquement et confessionnellement relativement homogène, les réseaux baathiste en Syrie ont fait la preuve de leur capacité à mobiliser les ressources militaires nécessaires à la défense du régime et à diviser la population en jouant sur le patchwork communautaire syrien, les minorités (Chrétiens, Alaouites, Chiites, Druzes…), confrontées à une opposition qui s’affirme de plus en plus en plus dans l’exclusive sunnite, s’étant après bien des velléités regroupées autour du président Bashar al-Assad, un président qu’elles n’apprécient pas nécessairement, mais qui leur apparaît comme le seul garant de leur sécurité.
Contrairement au cas de la Libye, où plusieurs États européens et les États-Unis ont déployé des moyens militaires considérables pour renverser le gouvernement de Mouammar Kadhafi et écraser sous les bombes atlantiques ses nombreux partisans (et ce, quelles qu’en furent les raisons non-avouées), les rebelles syriens, quant à eux, se sont trouvés dans le plus grand désarroi lorsqu’il se sont progressivement rendu compte que l’Occident n’avait aucun intérêt en Syrie et surtout pas celui de renverser un régime avec lequel l’Europe entretenait d’excellentes relations et qui avait trouvé avec Israël, pivot de la politique états-unienne dans la région, un modus vivendi plus que satisfaisant. Seuls et sans l’armement indispensable à combattre les unités fidèles au gouvernement, équipées et soutenues, en revanche, par de puissants États, piliers de la communauté internationale, la Russie, la Chine, l’Iran, mais aussi par des éléments régionaux comme le Hezbollah ou le gouvernement irakien de Nouri al-Maliki, les révolutionnaires n’avaient que peu de chance de remporter la victoire et, sans l’arrivée sur la scène des mouvements djihadistes, auraient probablement perdu la partie depuis des mois.
Contrairement, enfin, aux cas du Yémen ou du Bahreïn, presque-protectorats saoudiens (où les interventions de Riyad, respectivement diplomatique et armée, ont permis, d’une part, l’élection d’un nouveau raïs tout en préservant le statu quo et, d’autre part, d’écraser la rébellion), aucun acteur régional, en Syrie, n’a pu manier des leviers assez solides pour contraindre l’une des parties à céder à l’autre.
Les protagonistes du théâtre syrien, livrés à eux-mêmes, étaient donc condamnés à se faire une guerre sans merci qui, aujourd’hui, se traduit par les pires horreurs collectives et individuelles, plusieurs acteurs régionaux y ayant en outre ajouté leur grain de sel, propice à envenimer encore le drame, telles l’Iran et l’Arabie Saoudite, qui se font une guéguerre d’influence, jouant le chiisme contre le wahhabisme sunnite, la première pour protéger son meilleur allié dans le Monde arabe, par lequel transite l’aide destinée au Hezbollah libanais, et, l’autre, pour contrer les intrusions iraniennes au Bahreïn et au Yémen. Mais aussi le Qatar qui, toujours décidé à s’imposer comme la plaque-tournante de la diplomatie moyen-orientale, a accordé son aide aux réseaux djhadistes qui participent à sa sphère d’influence.
Pourtant, la communauté internationale aurait pu éviter à la Syrie cet auto-entraînement vers le chaos inextricable dans lequel elle se trouve aujourd’hui.
Entre mars 2011, en effet, date des premières secousses qui ont ébranlé la stabilité du régime, suite aux exactions de policiers responsables de la mort de plusieurs jeunes gens à Deraa qui, dans le contexte du « Printemps arabe », ont reçu un écho inhabituel, et l’organisation des élections que le président avait promises libres et honnêtes, en mai 2012, le pays a vécu dans un calme relatif. Seules trois villes secondaires ont connu à l’époque des soulèvements populaires violents mais très localisés et rapidement mâtés par l’armée, à savoir, pour l’essentiel, Homs, Maraat an-Nouman et Jisr al-Shougour.
Partout ailleurs, l’opposition peinait à mobiliser la population et les manifestations qui réclamaient le départ de Bashar al-Assad ou la réforme du régime ne rassemblaient guère plus que quelques centaines de participants, auxquelles répondaient les meetings monstres organisés par le pouvoir, des centaines de milliers de Syriens, qui exprimaient leur soutien à leur jeune président et à ses promesses de changement, y compris une large fraction de la communauté sunnite, à commencer par la bourgeoisie damascène et aleppine, pleinement satisfaite par les avancées économiques mises en œuvre sous l’égide de Bashar al-Assad depuis son accession au pouvoir en 2000 (cfr. Syrie, la «révolution» impossible (témoignage et analyse) – Grotius, février 2012).
Les espoirs attentistes de la majorité silencieuse furent cependant mis à mal et très profondément déçus, lorsque, en mai 2012, le régime resserra le collier en manipulant le scrutin, comme à son habitude, en déclarant inéligibles les opposants réels à la dictature, qualifiés de « terroristes ».
Cette fois, néanmoins, les bureaux de votes demeurèrent vides durant toute cette journée du 7 mai, qui marqua un premier tournant dans la crise syrienne.
Bashar al-Assad, le jeune président occidentalisé qui devait faire entrer son pays dans le XXIème siècle en rompant avec la tradition soviétique du régime instauré par son père Hafez, a manqué son entrée dans l’Histoire.
Probablement, à sa décharge, mal conseillé ou saboté par les caciques du parti Baath qui l’entourent –il est difficile de déterminer quelles furent les intentions effectives du président syrien qui porte aujourd’hui dans les médias la responsabilité de la tragédie qui anéantit son peuple-, n’a-t-il pas su réformer un appareil vieux de quarante ans et faire entrer la Syrie dans la modernité, ni socialement, ni politiquement.
2. Le soulèvement armé – L’Armée syrienne libre (mai 2012 – novembre 2012)
À l’inertie du régime et à sa politique de rétorsion policière et militaire coutumière, ont répondu des soulèvements armés, un peu partout dans le pays, encouragés par les succès apparents tunisien et égyptien, mais surtout par l’exemple libyen, qui avait reçu l’appui des puissances démocratiques de l’Occident.
Localement d’abord, systématiquement ensuite, dans les villages et les quartiers des grandes villes, des citoyens, de plus en plus nombreux, se sont réunis en sections d’autodéfense, qui accompagnaient les manifestations de l’opposition au régime et les protégeaient des incursions de la police et de l’armée et de la répression.
Les armes à feu y ont progressivement remplacé les armes blanches, inquiétant de plus en plus les autorités, puis ces groupes ont fait leur jonction et se sont organisés sur une échelle plus vaste, jusqu’à être rejoints par des soldats et officiers déserteurs de l’armée régulière, qui ont encadré et structuré ces groupes armés et les ont convertis en de véritables milices combattantes qui ont commencé à s’emparer de portions du territoire ainsi soustraites à l’autorité de l’État baathiste.
L’Armée syrienne libre (ASL) était née.
Lorsque des officiers supérieurs ont à leur tour emboîté le pas à l’insurrection, ils ont plus ou moins réussi à coordonner la quasi-totalité de ces milices à travers des Conseils militaires à l’échelle de chacun des gouvernorats du pays, qui furent eux-mêmes affiliés à un commandement commun, qui sera finalement proclamé à Idlib, en octobre 2012 (cfr. La révolution syrienne s’organise, mais se débat, seule, face à la machine de guerre du régime baathiste – Grotius, septembre 2012).
Parallèlement à l’organisation de cette branche armée laïque et multiconfessionnelle (dans la mesure où, rassurées par les garanties que présentaient les officiers de l’ASL, les minorités ont commencé à rallier la rébellion et ses objectifs démocratiques), s’est également édifiée une branche politique, en exil, dans le but de constituer un gouvernement provisoire capable de prendre en main la gestion immédiate de la Syrie dans l’espoir d’une victoire sur le régime.
D’abord très morcelée et dominée par le Conseil national syrien, lui-même placé sous la coupe des Frères musulmans syriens, cette opposition a réussi à surmonter ses divisions pour se rassembler dans une structure commune, en novembre 2012, la Coalition nationale syrienne (CNS), gouvernement provisoire d’union nationale représentative des différentes sensibilités politiques et dudit patchwork communautaire et ethnique syrien.
La Ligue arabe, Londres et Paris furent les premières à en reconnaître la légitimité et à en accueillir les ambassadeurs.
Un bureau militaire fut créé pour coordonner l’action de l’ASL et de la CNS.
La rébellion disposait ainsi des outils militaires et politiques capables, avec un accompagnement et un appui extérieurs, d’opérer efficacement la transition vers une Syrie démocratique sur le modèle européen.
Forte de sa progression et de son efficacité accrue, certaine, aussi, de l’imminence d’un soutien international que lui laissaient espérer les discours des chancelleries européennes et états-unienne, l’ASL avait lancé à Damas, le 17 juillet 2012, la « Bataille de libération de la capitale » et, le 20 juillet, la Bataille d’Alep, poumon économique de la Syrie. Deux fronts concomitants sensés diviser les forces du régime.
Bien entendu, la lutte ne pouvait se prolonger sans un apport d’armement aux combattants, qui, dans le cas contraire, risquaient une asphyxie à très court terme. En outre, craignant la victoire du régime, nombre de militaires hésitaient à déserter en faveur de la rébellion, attendant d’y voir plus clair, un acte concret des puissances de l’Ouest.
Les démocraties occidentales, cependant, ont sans cesse retardé leur soutien effectif à ces structures, alors que d’autres, en revanche, intervenaient secrètement et promouvaient une troisième composante du conflit qui n’allait cesser de se répandre et, phénomène spectaculaire, allait réussir à se rendre indispensable et, en moins de deux mois seulement, à s’imposer dans le conflit, au point de submerger soudainement le théâtre, à la surprise générale des apprentis sorciers de l’Ouest, mal informés des réalités galopantes d’un terrain en perpétuel mouvement…
3. De la révolution au djihad (novembre – décembre 2012)
Abandonnées par l’Occident, les structures de l’ASL se sont rapidement vidées de leurs effectifs. Dans certains gouvernorats, tels celui d’Idlib, d’ar-Raqqa ou de Deir ez-Zor, l’ASL a ainsi complètement disparu, au profit de mouvements djihadistes qui, largement financés et armés par les monarchies du Golfe, le Qatar et l’Arabie saoudite notamment, ont prospéré en quelques mois seulement (cfr. Syrie, de la révolution au djihad ? – Grotius, décembre 2012 etSyrie, quand les « Fous de Dieu » s’emparent de la révolution… – Grotius, février 2013).
Les katibas (brigades) de l’ASL, dépourvues d’armes et de munitions qu’elles ne pouvaient se procurer en suffisance, mais aussi des moyens logistiques nécessaires (vivres, vêtements, outils de communication…), n’ont pas été en mesure de rivaliser avec les katibas djihadistes. Les miliciens de l’ASL, dans la plupart des cas, ont donc abandonné leurs officiers et regagné leurs foyers ou intégré les katibas islamistes. Ce phénomène de vases communicants s’est généralisé à partir de novembre et décembre 2012, notamment du fait de l’hiver et des conditions climatiques qui ont poussé bon nombre de combattants à franchir ce pas.
La conséquence la plus immédiate a été la déconnexion des forces combattantes de la rébellion de leur représentation politique en exil : les chefs de l’ASL ne commandaient plus qu’une coquille vide, au point que certains officiers eux-mêmes sont passés dans le camp djihadiste ; et la CNS n’a plus eu aucune emprise réelle sur les opérations menées sur le terrain.
« Nous ne faisons pas la révolution ! Nous combattons pour Dieu ! » C’est le principe énoncé par la majorité des djihadistes rencontrés en Syrie, lesquels rejettent autant le gouvernement baathiste que la démocratie, « régimes corrompus » qui procèdent des lois des hommes et qui ne sauraient primer sur l’État islamique, qui émane des lois de Dieu.
L’absence de l’Occident dans le conflit syrien a donc ouvert le champ à l’hydre islamiste.
Cette absence s’explique par le non-intérêt des puissances au renversement du régime.
Ainsi, les quelques États européens qui se sont intéressés de près ou de loin à la Syrie, telles la France, bien sûr, ancienne puissance coloniale, mais aussi la Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Espagne, ont toujours entretenu des rapports cordiaux avec la famille al-Assad dont les intérêts n’ont jamais interféré avec les leurs. Mieux encore, depuis qu’elle a renoncé à l’énergie nucléaire, l’Allemagne, devenue un grand consommateur d’énergie fossile, de gaz et surtout de pétrole, s’est sensiblement rapprochée de la Russie, alliée de Damas ; l’Allemagne a donc tout à perdre à prendre fait et cause pour la rébellion en Syrie, au risque de se brouiller avec Moscou (Berlin a ainsi été le principal adversaire d’une intervention en Syrie et, même, de la proposition franco-britannique de fournir des armes aux rebelles, que ces deux puissances n’ont cela dit pas formulée sans la savoir condamnée à l’avance).
Quant aux États-Unis, ils n’ont jamais eu l’intention de se débarrasser d’un régime qui, depuis quarante ans, a garanti la stabilité régionale et, sans avoir jamais signé la paix avec Israël, en a pourtant assuré la sécurité sur la frontière du Golan. Certes, la Syrie a soutenu le Hezbollah dans son combat pour restaurer le pré carré libanais. Mais il s’est toujours agit pour Damas d’une carte régionale utile dont tout le principe résidait dans le fait de la réfréner et d’ainsi en jouer habillement à chaque occasion.
La politique états-unienne à l’égard de la Syrie consistait au contraire à imposer un progressif réalignement de Damas, au détriment de Moscou ; et Bashar al-Assad jouait assez bien le jeu et, d’année en année, se rapprochait de l’Ouest.
C’est pourquoi Washington s’est retranchée derrière les vetos russe et chinois qui, au Conseil de Sécurité des Nations unies, empêchaient toute intervention en Syrie, mais aussi derrière le principe d’une ligne rouge, celle de l’emploi éventuel par le régime syrien d’armes chimiques ou biologiques contre sa propre population, au-delà de laquelle l’intervention était envisageable. Le président Obama savait pertinemment que le régime syrien n’avait aucun intérêt à employer ces armes, dont l’usage aurait non seulement entraîné une réaction hostile de la communauté internationale, mais également mis en difficulté la Russie et la Chine, qui auraient eu bien du mal à continuer de protéger ouvertement leur allié.
Il est cependant toujours périlleux de définir une ligne rouge, car ceux qui y ont intérêt mettent tout en œuvre pour la faire franchir (une ligne rouge, celle de l’emploi des armes chimiques, qui est par ailleurs très hypocrite : le régime a bombardé des hôpitaux, des rassemblements de civils qui attendaient des distributions de pain, des écoles, etc. ; dans le cas du conflit syrien, l’arme de destruction massive, c’est l’AK-47, la kalachnikov, et pas le gaz).
Le président Obama fut donc pris à son propre jeu lorsque, en août 2013, du gaz sarin fut utilisé dans la banlieue damascène d’al-Ghouta, provoquant le décès de plusieurs centaines de civils, et que la responsabilité en fut attribuée par les rebelles au gouvernement de Bashar al-Assad (qui ne pouvait pourtant escompter obtenir aucun avantage militaire à l’issue de cette manœuvre). La Maison blanche devait désormais intervenir, sous peine de se discréditer très largement.
D’où la porte de sortie que Barack Obama a immédiatement empruntée lorsqu’elle lui a été ouverte par le président russe, Vladimir Poutine, qui, en l’absence de certitude sur l’identité des auteurs du drame d’al-Ghouta, a proposé, pour couper court, de placer l’armement chimique syrien sous le contrôle de la Russie. Une proposition qui, selon les informations publiées par Le Monde diplomatique (octobre 2013), ne date pas de la crise générée par les événements d’al-Ghouta, mais fait l’objet de négociations entre Moscou et Washington depuis un an déjà, avec l’assentiment de Vladimir Poutine, soucieux de mieux contrôler son dernier allié au Moyen-Orient…
La décision de saisir la main tendue par la Russie fut d’autant plus facile à prendre que la donne géopolitique a sensiblement changé pour Washington : jusqu’à présent, la Maison blanche jouait les équilibristes, politique de bascule délicate entre sa volonté d’affaiblir le régime syrien (sans le faire chuter) pour contrer l’Iran et ses efforts pour contrôler son allié saoudien et en modérer les attaques contre Damas (les États-Unis avaient notamment empêché l’Arabie saoudite de livrer massivement des roquettes anti-char aux rebelles). Désormais, cependant, la problématique ne se pose plus en ces termes.
En effet, comme l’a montré l’éviction des Frères musulmans en Égypte, l’Arabie saoudite a mis en sourdine sa politique de déstabilisation de la Syrie : le développement exponentiel des mouvements djihadistes salafistes soutenus principalement par les Saoudiens et les Qatari en Syrie, en Tunisie, en Libye et en Égypte a pris des proportions telles que le Wahhabisme de Ryad s’en est senti menacé dans son propre fief. Court-circuitant son petit allié qatari toujours en quête de reconnaissance régionale, l’Arabie saoudite a donc brusquement inversé sa politique de soutien aux Frères musulmans en Égypte, lesquels, discrédités par l’exercice maladroit du pouvoir, faisaient au Caire le lit de l’intégrisme salafiste, leurs partisans rejoignant en masse le mouvement salafiste du Hezb al-Nour, une hémorragie qui commençait à inquiéter Ryad. Le feu vert fut donc accordé aux militaires pour une reprise en main draconienne d’un État qui, à ce jour, demeure l’axe central du Monde arabe.
Par ailleurs, l’élection du président Hassan Rohani en Iran, en juin 2013, a également modifié le théâtre régional : les États-Unis avaient déjà commencé une ouverture diplomatique franche et large à l’époque du gouvernement Khatami ; et l’élection de Rohani, après les deux mandats de Mahmoud Ahmadinejad, leur donne la latitude de reprendre les négociations là où elles en étaient restées.
En Iran, pour dire les choses simplement, deux camps s’affrontent, en dehors des clivages occidentaux généralement admis. Les « conservateurs de gauche » et les « progressistes de droite ». À savoir les conservateurs, sur le plan religieux ; il s’agit de Mahmoud Ahmadinejad et de ses partisans, que l’on peut parallèlement classer à gauche, sur le plan social. L’électorat d’Ahmadinejad se situe ainsi dans les campagnes défavorisées et les banlieues pauvres des villes. Et les « réformateurs de droite » ou les « progressistes de droite » ; progressistes sur le plan sociétal mais qui, sur le plan économique, sont très à droite, prêts à privatiser les ressources pétrolières du pays qui financent la sécurité sociale, assez performante en Iran.
Mohammad Khatami avait effectué un rapprochement certain avec les Etats-Unis ; il était prêt à en finir avec la guerre larvée qui date de 1979, c’est-à-dire en finir avec certains principes de la révolution islamique et permettre l’ouverture aux sociétés américaines dans les champs pétroliers iraniens. Opposé à cette politique, Mahmoud Ahmadinejad était l’homme à abattre. Et c’est chose faite.
Hassan Rohani traite aujourd’hui avec mépris les réalisations sociales de son prédécesseur et en parle comme s’il s’agissait d’une parenthèse regrettable dans l’histoire du pays et pousse le mea culpa jusqu’à faire des courbettes à l’intention d’Israël en affirmant, dans un discours récent, que l’Iran n’a jamais nié l’Holocauste. Cette thématique récurrente s’impose donc jusqu’à Téhéran. En outre Rohani s’est directement acoquiné avec le vieux renard de la scène politique iranienne, champion de la corruption, Hachémi Rafsandjani, qui se frotte déjà les mains d’un come-back dans le jeu. Le temps des vaches grasses est de retour pour la droite progressiste.
Du fait de la victoire des « progressistes de droite », les Etats-Unis peuvent assouplir leur politique à l’égard de l’Iran.
Le raz de marée djihadiste en Syrie et l’élection du président Rohani en Iran ont ainsi entraîné un remaniement complet du jeu géostratégique régional autour de Damas et du régime baathiste.
Les États-Unis ont donc décidé de na pas intervenir en Syrie, unilatéralement, et la France de François Hollande, qui, dans le cadre de sa politique d’influence qatarie, sonnait déjà du clairon, a dû ranger tambours et trompettes et suivre les sentiers tracés par son maître en effectuant une remarquable volteface (il faut en finir avec ce refrain récurrent que l’on fredonne depuis une vingtaine d’années à Paris : le « déclin de l’empire américain », ça n’existe pas !).
Sans ambiguïté aucune, la rébellion syrienne, dans sa version laïque et démocratique, était bel et bien seule, depuis le tout début du conflit qui allait l’opposer au régime en place, et le reste aujourd’hui, plus que jamais.
4. Islamismes et banditisme (janvier 2013 – septembre 2013)
Lorsque je suis entré en Syrie en avril dernier, pour un huitième séjour d’observation, trois jours avant d’être enlevé, je me suis rendu à Yabrud avec la katiba d’un commandant de l’ASL, Abou Youssaïfa.
Ayant aperçu la cathédrale de la ville, très proche du chemin que nous empruntions, j’ai demandé si nous pouvions nous y arrêter. Ma requête ne semblait pas trop plaire à mes hôtes, mais j’ai insisté et ils ont finalement cédé.
Par chance, nous avons croisé un des responsables de l’évêché catholique de Yabrud. J’en tairai le nom, pour sa propre sécurité… Il sortait de la cathédrale à l’instant où nous descendions de voiture. Il avait étudié la théologie en Belgique, à l’Université de Louvain, et parlait un excellent français, ce qui nous a permis de nous entretenir plus librement, sans que mes amis de l’ASL, qui, l’air inquiet, ne nous lâchaient pas d’une semelle, pussent comprendre la teneur de nos propos.
Le prêtre accepta de me parler sans réserve, mais commença par me faire visiter l’édifice, ancien temple romain transformé en église au VIIème siècle, gesticulant ostensiblement en désignant de la main icônes et colonnades… Cette visite touristique m’apparut surréaliste, mais j’en compris rapidement les raisons, lorsqu’il me l’expliqua, à l’abri de la sacristie où, trop exiguë pour accueillir aussi mes amis révolutionnaires, nous avions trouvé refuge : il ne devait pas donner l’impression aux miliciens de l’ASL qu’il m’avait parlé d’autre chose que de vieilles pierres.
La communauté chrétienne de Yabrud, m’apprit-il effectivement, est sans cesse rançonnée par « ces gens-là » :
– Nous leur payons chaque semaine de petites sommes, pour qu’ils nous laissent tranquilles, poursuivit-il. Mais ça ne suffit pas : ils s’en sont pris plusieurs fois à de riches commerçants. Certains ont été enlevés et ont payé pour être libérés. Beaucoup des membres de notre communauté ont finalement décidé de s’en aller. Plusieurs centaines sont déjà parties au Liban ou à Damas…
– Mais l’Armée syrienne libre ne vous protège-t-elle pas ?, lui ai-je demandé.
– L’Armée libre ? Quelle armée libre ? Il n’y a plus d’Armée libre ! Ce ne sont plus que des bandes de brigands qui vivent sur le dos de la population !
– Pourtant, il existe un commandement supérieur, auquel vous pouvez vous plaindre de ces exactions.
– Oui, nous sommes allés à plusieurs de leurs réunions. Ils ne peuvent rien faire contre leurs propres troupes. Chacun n’en fait qu’à sa tête. Ils n’ont aucun projet politique pour l’avenir. Je leur ai demandé : « Qu’est-ce que vous ferez quand vous aurez renversé Bashar ? » ; ils m’ont répondu : « On verra. » « Et pour nous, les Chrétiens, qu’en sera-t-il dans votre nouvelle Syrie » ; ils m’ont encore répondu : « On verra. » C’est bien ce qui nous inquiète ; oui, nous aussi, « on verra »…
Abou Youssaïfa ne nous a pas laissé poursuivre cette conversation bien longtemps : il a poussé la porte de la sacristie et demeurait sur le seuil, en m’exhortant de ne plus tarder à reprendre la route…
Au-delà du cas spécifique des Chrétiens d’Orient, qui vont, une fois encore, faire les frais de la radicalisation islamiste, le phénomène ici décrit n’est pas distinctif du conflit syrien : l’historien britannique Eric Hobsbawm (Bandits) a montré que les révolutions ont souvent été l’occasion pour les marginaux et les déclassés, dans les circonstances où l’État n’a plus la force de faire respecter la loi, de prendre une revanche sociale à travers le banditisme.
Par contre, le fait que certaines katibas de l’ASL se soient muées en bandes criminelles est tout à fait symptomatique de ce que j’ai développé plus haut. Certains groupes, ainsi, s’agressent mutuellement dans les villes sous contrôle de la rébellion, pour la mainmise sur un quartier ou une rue commerçante…

Mais, au-delà d’un banditisme structurel, c’est le djihadisme qui menace désormais la révolution syrienne en s’imposant partout et par la force lorsque l’ASL tente de lui résister (cfr. carte).
En effet, depuis l’été 2013, les organisations djihadistes ont dévoilé leur jeu et n’hésitent plus à attaquer des positions de l’ASL pour s’en emparer. Ce fut le cas, spectaculaire et sans appel, de l’attaque du poste frontière d’Azaz, enlevé à l’ASL par les djihadistes de l’État islamique de l’Irak et du Levant (EIIL), en septembre. En octobre, une soixantaine de miliciens de l’ASL étaient massacrés dans les rues d’Alep lors d’âpres combats qui les opposaient à des katibas djihadistes. Et l’on évoquera encore les enlèvements à répétition de journalistes occidentaux, qui se sont multipliés depuis juin 2013, victimes de ces mouvements islamistes. Ou les menaces de morts proférées à l’encontre des opposants qui se rendraient à la table des négociations de « Genève II ». Pour ne faire ici état que des faits les plus significatifs… Mentionnons aussi la question kurde et les actions militaires menées par le PKK qui avait envisagé de détacher certaines régions du pays qu’il contrôlait déjà et que menace dorénavant l’avancée djihadiste.
Les organisations djihadistes présentes en Syrie sont innombrables, de la plus puissante, Jabhet al-Nosra, aux plus intégristes, Ahrar as-Sham et Suqqur as-Sham, en passant par les moins intolérantes, Liwa al-Towheed, Liwa al-Fata, etc. ; et certaines ne sont pas encore répertoriées.
Toutefois, il semble que, depuis peu, la fusion de ces différentes composantes du djihadisme syrien soit en train de se réaliser, sous l’égide d’une formation nouvellement déclarée et qui tendrait à radicaliser l’ensemble des combattants et à les entraîner dans l’obédience d’al-Qeada (historique) en Péninsule arabique (AQPA).
Depuis quelques mois, en effet, l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL), qui aurait rallié à sa cause la plupart des katibas de Jabhet al-Nosra, étend son influence sur tout le nord et le centre de la Syrie, depuis le gouvernorat d’ar-Raqqa où il a proclamé un califat indépendant placé sous la loi coranique, la Charia, fin juillet 2013.
L’EIIL est aujourd’hui devenu le principal mouvement d’opposition au régime ; le djihadisme est le rival du régime le plus susceptible de l’inquiéter. L’ASL, quant à elle, marginalisée et partout évincée, ne compte plus (ou presque) pour rien sur l’échiquier syrien.
*
* *
La révolutions syrienne, incontestablement, a évolué de manière continue – il est à présent nécessaire d’écrire l’histoire de ce conflit atypique – et se perd aujourd’hui entre banditisme et islamismes divers, islamismes « feints », « modérés » ou « radicaux », qui s’attaquent sans remord ni vergogne aux reliquats de l’Armée syrienne libre, finalement mise hors jeu, le tout sur fond de crise humanitaire (cfr. Crise humanitaire pour une guerre oubliée : « Ce sera Bashar, ou nous détruirons la Syrie » – Grotius, mars 2013), une catastrophe pour la population civile qui n’a jamais mobilisé les États dominants et les préoccupe moins encore depuis que leur attention semble avoir été alertée et s’être focalisée sur le danger intégriste.
Les derniers bastions de l’ASL, à n’en pas douter, finiront pas céder. Nombre de mes contacts dans l’ASL ont déjà rendu leur tablier et fuient avec leur famille, en Turquie, au Liban, mais aussi vers l’Europe, sans espoir ni désir de retour, et parfois comme clandestins.
Déjà, on peut constater une forme de « somalisation » du conflit et esquisser des parallèles éloquents : de même que les Shebabs, les islamistes radicaux, s’étaient imposés en Somalie et avaient combattu les seigneurs de la guerre issus de la rébellion contre la dictature de Siyaad Barre et qui rançonnaient les habitants des zones passées sous leur coupe, de même, les combattants de l’État islamique d’Irak et du Levant arraisonnent les bandits, restaurent l’ordre et la loi, fût-elle coranique, et reçoivent bon accueil d’une large partie de la population sunnite. Le parallèle est significatif.
Cette « involution » de la révolution syrienne laisse tous les protagonistes dans l’expectative, sauf peut-être les islamistes, qui s’emparent du pays.
Revenons à Fontenelle : pour l’Occident, il est désormais trop tard pour intervenir. Trop tard, car l’ASL ne dispose plus des effectifs qui lui permettraient de reprendre le dessus sur les organisations djihadistes ; trop tard, car il ne reste plus grand monde à soutenir, dans le camp de la démocratie.
Il est trop tard également pour envisager une solution politique au conflit, devenue illusoire : les adversaires du régime, à ce stade des événements, bien plus que l’ASL et son pendant politique, la Coalition nationale syrienne, ce sont les mouvements djihadistes, qui tiennent plus de la moitié du pays et ont déjà entrepris d’y remplacer institutionnellement le gouvernement de Bashar al-Assad, comme en témoigne l’instauration du Califat d’ar-Raqqa. Or, ces mouvements ne négocient pas. Ce n’est pas dans leurs intentions. Ils font le djihad, la guerre sainte, et ne sauraient tolérer le maintien de l’État syrien.
L’évolution récente et subite dont nous venons de faire état, dernier rebondissement en date du conflit syrien, a modifié sensiblement l’approche qu’en avaient les chancelleries occidentales, lesquelles ont déjà, pragmatiquement, commencé à réhabiliter le régime baathiste.
Mais ont-elles conscience de l’ampleur des conséquences du « Printemps arabe » et ont-elles pris la mesure du danger qui les menace ?
Ce danger est d’abord régional : de sources diplomatiques, les services de renseignement turcs et jordaniens ont identifié des cellules djihadistes dormantes qui ont franchi leurs frontières et se sont introduites sur leur territoire respectif à la faveur du flot de réfugiés qui s’y sont installés.
C’est ensuite un danger pour l’Europe : « Après avoir converti tous les Arabes, nous reprendrons aux Chrétiens al-Andalous (l’Espagne) », m’a expliqué le commissaire politique d’une katiba d’al-Qaeda, au sein de laquelle j’ai été détenu en mai 2013. « Et, de là, nous porterons la parole de Dieu sur toute l’Europe où nos frères nous attendent déjà. »
Il ne faudrait pas sous-estimer, en effet, le potentiel de nuisance du fait djihadiste en Syrie : pour la première fois dans l’histoire contemporaine, un État djihadiste est en train d’émerger. Un État frontalier de la Turquie, c’est-à-dire de l’OTAN, de l’Irak et de ses réserves pétrolières, de la Jordanie, du Liban et, plus notablement encore, d’Israël. Un État qui possède une façade maritime en Méditerranée, à quelques encablures de Chypre, c’est-à-dire de l’Union européenne.
D’un problème sécuritaire d’ordre policier, celui du terrorisme islamiste, le conflit syrien a transformé l’intégrisme musulman en une problématique d’ordre militaire, sur le long terme.
Lien(s) utile(s) : Grotius international – Géopolitique de l’Humanitaire
A lire absolument : SYRIE – « Ce sont les rebelles qui ont utilisé le gaz sarin ! »
Et aussi : SYRIE – « Reynders a saboté ma libération »
SYRIE – La « révolution » syrienne : le djihad aux portes de l’Europe
KRO – Brandpunt : Gevangen in chaos (een reportage van Henk van der AA)

ltalië betaalde 4 miljoen dollar voor ontvoerde Belg en Italiaan, De Tijd, 2 november 2013
Lire aussi :
et
Lire encore :
À consulter :
Syrie, une pépinière djihadiste ?
Voir également :

© Cet article peut être librement reproduit, sous condition d’en mentionner la source