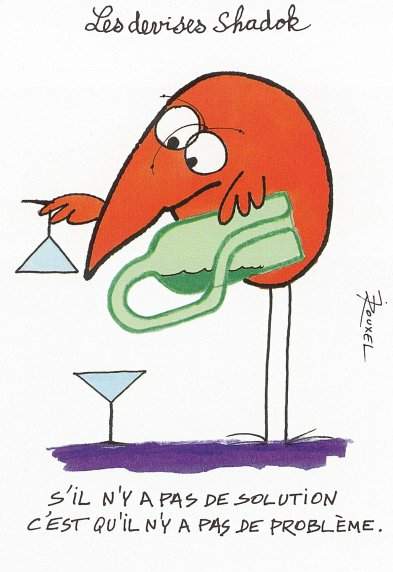Pierre Piccinin retourne en Syrie. Depuis les incidents de mai dernier, il pense fermement que le régime ne peut se réformer. Il a conservé ses contacts parmi l’opposition syrienne et a décidé d’y retourner, pour continuer ses « missions d’observation », comme il dit. « Le Soir » publiera ses chroniques en exclusivité. Voici la première livraison, envoyée samedi de Turquie.
I. La « Mère de toutes les batailles »
Antakya, Turquie (26 au 28 juillet 2012) – À l’annonce des événements qui se préparaient en Syrie, je me suis mis en route, tout droit de Tunis à Adana, dans l’est de la Turquie. De là, par la route, j’ai gagné Antakya, aux confins du pays.
Il ne reste rien de l’antique Antioche, mère des Églises chrétiennes d’Orient ; dans la province turque du Hatay, le Sandjak d’Alexandrette, arraché à la Syrie par la Turquie, en 1939, avec la complicité du Protectorat français, la vie paisible et morne des paysans suit son cours, pas même perturbée par les drames effroyables qui se jouent à quelques kilomètres de là, derrière la frontière syrienne.
Je devais y retrouver Manhal, un de mes contacts, rencontré à Hama en décembre 2011.
Il y coordonnait les manifestations et m’avait permis de visiter les dispensaires clandestins où les contestataires soignaient leurs blessés. Recherché en tant qu’activiste, sa vie était en grand danger et, fin juin, il avait été exfiltré vers la Turquie.
Depuis le début des événements, en mars 2011, Hama a été l’un des fiefs de la rébellion. Pendant des mois, ses habitants ont manifesté de manière pacifique ; beaucoup d’entre eux croyaient dur comme fer aux promesses de réformes du président Bachar al-Assad et condamnaient sévèrement les premiers signes de militarisation de la révolution, que j’avais déjà constatés lors de mon premier séjour d’observation, en juillet de la même année, à Homs notamment.
Mais, aujourd’hui, même à Hama, on espère l’arrivée de l’Armée syrienne libre (ASL) et, même à Hama, on prie pour une intervention occidentale. Parce que, aujourd’hui, Hama est sous le feu des snipers du gouvernement, qui empêchent tout rassemblement ; et l’armée occupe places et boulevards.
Et aussi, en mai, il y a eu les élections, ces « élections libres et ouvertes à l’opposition » promises par Bachar al-Assad. Oui, mais, voilà : les partis d’opposition ont été qualifiés de « mouvements terroristes » ; ils n’ont pas été autorisés à présenter leurs candidats. Et seule l’opposition « officielle », au service du régime, a pu participer au scrutin.
Depuis lors, les citoyens ont perdu toute confiance ; ils ne croient plus aux promesses. Et les autorités n’osent plus organiser les manifestations fleuves en soutien au président, qui inondaient de monde les rues de Damas ou d’Alep, comme j’avais pu le constater en janvier encore. Le gouvernement a peur, à présent, de voir cette foule se cabrer brusquement et hurler au départ de Bachar, à la fin de la dictature, et devenir incontrôlable.
Et le régime ne veut plus d’observateurs indépendants sur le sol syrien, aucun témoin. Même ceux qui ne lui étaient pas d’emblée défavorables et cherchaient à comprendre la réalité du conflit sont devenus persona non grata. J’en ai fait l’expérience en mai, lorsque, entré en Syrie par la frontière libanaise, pourtant muni d’un visa en règle, j’avais été arrêté par les moukhabarat, les services secrets, après seulement quelques jours : dans l’enfer de leur centrale de Homs, ils m’avaient administré une sévère correction, avant de m’expulser six jours plus tard ; le message était clair : je n’avais plus rien à faire là.
C’est que le régime, sûr de la protection que lui garantissent la Chine et la Russie, ne fait plus preuve d’aucune modération : depuis la mi-mai, l’armée bombarde massivement toutes les villes insurgées, sans plus se soucier des observateurs de l’ONU déployés en Syrie dans le cadre du Plan Annan ; et les services secrets arrêtent, tuent et torturent les manifestants. Ils ne s’en cachent plus ; ils ne se sont pas privés de me le faire savoir, lorsque j’étais en prison : j’ai tout vu, et on m’a cependant laissé partir.
Un an et quatre mois après le début des troubles, le gouvernement de Bachar al-Assad n’a plus aucune légitimité. Mais il tient toujours, grâce à l’inertie de l’Occident – qui n’a pas même accepté de donner des armes aux insurgés –, et il pourrait tenir encore longtemps et réussir à écraser la révolution.
C’est pourquoi plus de cent mille Syriens ont fui les zones des combats et s’entassent dans des villes de tentes, derrière les frontières d’Irak, de Jordanie, du Liban et de Turquie. L’affolement de ces dernières semaines en a précipités plus encore ; et il est temps que les Nations unies mobilisent les moyens nécessaires pour répondre à ce qui se dessine sous les traits d’une crise humanitaire.
C’est dans un des camps de réfugiés de la province de Hatay que je devais retrouver Manhal. Nous nous y étions donné rendez-vous. Mais, quand j’y suis arrivé, il était déjà reparti. Il m’avait laissé un message : « Je ne peux pas rester là, sans rien faire ; je ne veux pas finir comme les Palestiniens, qui vivent dans des camps depuis soixante ans ; ma maison est à Hama, c’est là que je veux vivre ; c’est chez moi ; tant pis pour les risques ; je pars au combat ».
J’ai en revanche retrouvé des habitants de Tal-Biseh, une petite ville au nord de Homs. Le 16 mai, la veille de mon arrestation, j’y avais rencontré l’ASL, qui tenait la ville ; j’étais le seul observateur sur place, et ils m’avaient fait toute une fête. Quelques jours après mon retour en Belgique, j’avais appris que Tal-Biseh était soumise à d’intenses bombardements. Mes contacts à l’intérieur de la ville m’avaient informé que plus de 80 % de la population avaient fui. Peu après, j’avais reçu leur dernier message : « L’armée est dans la ville ; nous sommes tout seuls ; personne ne nous aide ; mais souviens-toi de nous ». Je me souviens d’eux…
Ces gens, démunis, qui vivent sous les tentes de l’armée turque, sans même savoir si leur maison est encore debout, n’ont pas pu me dire si Tal-Biseh tenait encore ou si l’ASL y avait été vaincue.
Il n’est pas aisé d’accéder aux camps de réfugiés : l’ambassade de Turquie à Bruxelles m’en avait refusé l’autorisation, « par respect pour l’intimité des personnes réfugiées » (sic) et, sur place, la procédure demande plusieurs jours d’attente, pour obtenir une réponse souvent négative. Les hôtels d’Antakya sont emplis de journalistes qui attendent en vain. Les autorités turques ne souhaitent pas la présence d’observateurs étrangers, et pour cause…
Alors que la Turquie entend gérer seule l’afflux de réfugiés qui arrivent sur son sol, refusant l’aide proposée par d’autres États, les conditions de vie dans la dizaine de camps établis tout le long de la frontière sont proprement effarantes. C’est du moins ce que j’ai pu constater au camp d’Altinózü, au sud d’Antakya, l’un des trois sites d’accueil de la province de Hatay ; et ce n’est pourtant pas le pire, à en croire les contacts qui m’ont permis d’y pénétrer.
Les barbelés qui entourent le camp ne sont en effet pas partout infranchissables : un menuisier, voisin du camp qui jouxte la bourgade, nous a laissé monter sur le toit de sa maison, depuis lequel il est possible, le soir tombé, de se laisser glisser dans le camp à l’aide de cordages…
Tout de même mieux organisé que les camps de réfugiés au Liban, dont celui de Wadi Khaled, que j’avais visité en mai dans les mêmes conditions, le camp d’Altinózü se compose de vastes hangars de tôle, auxquels ont été ajoutées quelques files de tentes juxtaposées, à l’enseigne du Croissant-Rouge turc. Pas une herbe, pas un arbre. Par 42ºC à l’ombre.
Le manque de place est tel que chaque tente abrite deux et parfois même trois familles, entassées dans l’air suffoquant et moite qui accable la province de Hatay tout l’été durant, tandis que de nouveaux réfugiés arrivent tous les jours.
L’eau potable manque. Les sanitaires sont insuffisants et les toilettes débordent. Et les denrées se vendent à prix d’or, en fonction d’un marché noir et d’une pénurie cyniquement entretenus par les gardiens du camp eux-mêmes, qui trouvent dans le malheur des familles réfugiées une manne inespérée… Dès lors, la nourriture fait parfois défaut, car, coupées de leurs parentèle et sans revenus, ces familles n’ont pas toutes la possibilité de s’approvisionner régulièrement.
« Nous sommes reconnaissants au gouvernement turc de nous donner l’asile », m’a confié Samou, un jeune chrétien, arrivé au camp début juin. « Mais les policiers ne nous aiment pas ; ils n’aiment pas les Syriens et ils exploitent notre malheur tous les jours ; ils n’ont aucune pitié : moi, je préférerais être dans ma maison, avec mes sœurs, et boire le vin frais sous la treille du jardin, mais vous savez bien ce qui se passe, chez nous ; ici, parfois, on n’a même pas d’eau pour se laver. »
Aussi, les coups de colère sont presque quotidiens. Les pauvres gens sont à bout et certains ont déjà décidé de prendre le risque de retourner vivre dans ce qui reste de leur village. « Ils ne veulent pas de nous, ici, m’a lancé une vielle femme. C’est pour cela qu’ils ne nous donnent rien à manger ; pour qu’on s’en aille et qu’on les laisse tranquilles. »
Mais la plupart n’a pas le choix : ce sont les familles des combattants de l’ASL, qui les ont mises ici à l’abri. En Syrie, ils sont connus ; c’est principalement le cas des déserteurs. Et la vie de leurs proches est dès lors menacée par les représailles du régime, qui veut faire des exemples pour dissuader d’autres militaires d’abandonner l’armée régulière. Mais, sachant leur famille à l’abri, les hommes peuvent aller se battre pour renverser la dictature : « Pourquoi je me bats ? », m’a répondu Mounir, quarante-deux ans, sunnite. « Vous ne savez pas, vous, en Europe, ce que c’est d’être humilié tout le temps : il faut payer des pots-de-vin pour tout ; il faut payer la police ; ils peuvent prendre votre maison, s’ils veulent. On a pris l’appartement de mon cousin ; un homme qu’il ne connaît pas s’est installé chez lui ; il a demandé des comptes au gouvernorat, et on l’a arrêté : les policiers l’ont frappé en prison pendant trois jours ; je n’ai pas reconnu sa figure quand il est sorti, sauf ses yeux. Moi, je ne veux rien que vivre avec ma femme et mes enfants ; c’est tout. On a une chance de pouvoir changer ça ; c’est pour ça que je me bats ».
Ce samedi soir, je rejoindrai une unité de l’ASL. Les hommes m’attendent à la frontière, dont ils contrôlent plusieurs postes douaniers ; nous avons rendez-vous à Gaziantep, une petite ville, à un long jet de pierre de la Syrie.
Avant d’entrer à nouveau en Syrie, j’ai demandé que l’on m’apprenne à utiliser correctement une Kalachnikov, la seule arme à disposition des rebelles. Si nous rencontrions un problème… Je ne veux en effet en aucun cas retomber dans les griffes des services secrets.
On peut bien sûr être très critique concernant la révolution syrienne. Je l’ai été, je le suis encore, et j’estime qu’il s’agit là d’une saine démarche. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’elle se débat dans des conditions extrêmes, sans aide extérieure et face à la machine de guerre d’un régime politique impitoyable, qui lui fait payer un lourd tribut en victimes civiles plus encore que militaires.
Il ne faut donc pas se laisser distraire par des constatations certes pertinentes, mais secondaires, et oublier que les revendications des insurgés sont honnêtes et légitimes…
J’entrerai avec ces hommes dans un pays en guerre, dont le gouvernement menace maintenant d’utiliser des armes chimiques.
Depuis le vendredi 20 juillet, l’ASL a déclenché une vaste offensive dans cette région, autour d’Alep (dans le nord de la Syrie). Les massacres se sont succédé depuis deux mois, et il n’est plus temps de tergiverser : « Il faut gagner ou mourir », m’a écrit Manhal.
Peu avant, elle avait lancé la « Bataille de libération de Damas ». Ce fut un échec… Faute d’un soutien des démocraties occidentales, toujours imperturbables face à l’assassinat du peuple syrien par l’arsenal militaire du régime baathiste, l’ASL a dû reculer devant les compagnies de chars d’assaut et le déploiement d’hélicoptères de combats dans le ciel de la capitale.
Et les quartiers insurgés ont été « nettoyés » des « terroristes », selon le jargon de la propagande mise en œuvre par la télévision d’État.
Le président Assad l’avait annoncé : désormais, c’est dans le nord, le long de la frontière turque, que l’armée régulière va concentrer ses efforts. C’est sur Alep, Idlib, Hama, Rastan, Tal-Biseh, Homs… qu’est menée une contre-offensive d’envergure, dont l’objectif est l’élimination totale de la résistance à la dictature.
Avec les soldats de l’ASL, nous marchons en direction de cette contre-offensive, qui a commencé ce matin et dont les mouvements les plus décisifs sont pour les prochains jours…
Car ce n’est plus de Damas qu’il s’agit aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est ici, à Alep, que va se jouer la « Mère des Batailles », selon les termes du président Assad ; c’est maintenant l’heure de la Bataille de Syrie.
source







 © AFP
© AFP